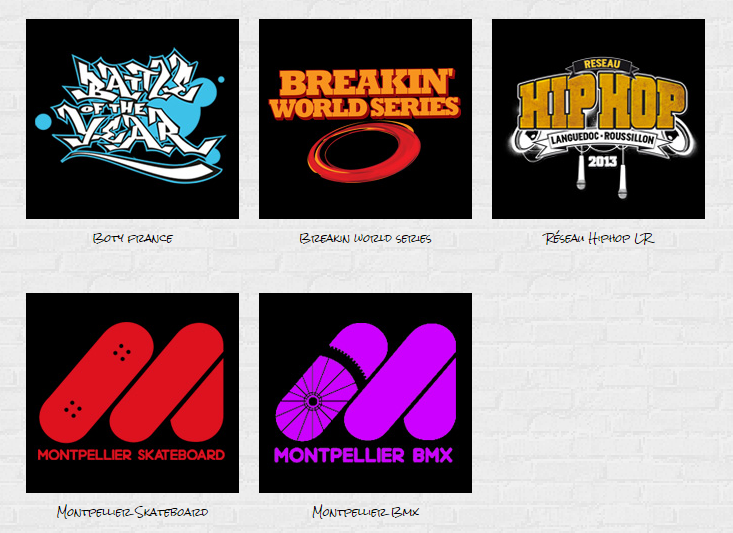Thomas Raymond, membre de l’association Attitude, Part. III
Union Urbaine est allé voir du côté d’Attitude, une association qui impulse plusieurs actions à Montpellier dont le Battle of the Year depuis presque vingt ans tout en accompagnant les artistes vers leur professionnalisation et en leur proposant des espaces de travail. Après avoir évoqué les différents parcours des rappeurs de la région comme Joke, Némir ou Set&Match et être revenu sur les prémices de l’association (relire la deuxième partie), Thomas fait le point sur la situation des cultures urbaines à Montpellier, tout en revenant sur le manque d’expertise des politiques.
Union Urbaine : Il y a moins d’aide aujourd’hui ?
Thomas Raymond : Montpellier, c’est un gros vivier de danse, c’est une ville de danse contemporaine et au niveau musique actuelle, c’est pareil. C’est un long cheminement compliqué pour faire accepter ça. Justement avec la salle victoire 1 au départ, avec la salle victoire 2 ensuite…qui est on va dire le parent pauvre de la culture populaire à Montpellier. Enfin tout ce qui est culture populaire de toute façon, ça fait pas partie du schéma culturel originel de Montpellier. Donc du coup voilà, on a commencé à faire ça, ça a pas mal marché, des artistes comme Némir, Set et Match qui sont sortis.
« Set&Match, Némir, on les a aidés »
Ils sont sortis grâce à vous ?
Nous on les a aidés, parce que ces dispositifs-là… Il y a les dispositifs affichés, et il y a tout ce qui se passe de façon formelle. Parce que nous, au départ, on est parti sur des accompagnements qui étaient un peu tous azimuts. Le but, c’était pas non plus d’être trop dans une démarche institutionnelle… le but c’est surtout d’arriver à identifier des artistes, des parcours, ou des envies de parcours, parce qu’il y a pas mal d’artistes qu’on a aidés et qui finalement se sont aperçus que c’était pas forcément leur vocation. Ils sont partis vers autres chose, des formations professionnelles différentes, sur du montage de projet culturel, en se disant : « Voilà on a fait le test, on a essayé, on n’est pas chorégraphe, on n’est pas artiste rap. »
« Ce qu’on cherche, c’est offrir des dispositifs »
L’idée c’est aussi de juste proposer une alternative aux gens ?
Ah bah oui ! Le piège c’est ça. Le but c’est de faire justement cette espèce d’antichambre qui permet à certains qui ont effectivement envie de se professionnaliser, d’être visible, de se structurer, d’être éligible sur des dispositifs, qu’ils soient publics ou privés. Et en même temps, il ne faut pas se couper de la base, parce que sinon on remplace la filière Skyrock, avec des bureaux qui sont fermés, des dispositifs qui ne toucheront plus le vivier local. Le but c’est surtout ça, c’est d’offrir des dispositifs et après, il y en a certains qui changent de route, mais ça fait partie de la vie. On s’adresse à des jeunes artistes, à des gens qui sont souvent autodidactes, avec des envies pas forcément pré-définies ou tracées, donc si effectivement ça permet à certains de s’apercevoir qu’il faut changer, que l’orientation artistique choisie au départ n’est pas forcément celle qui va porter ses fruits professionnellement, on a aussi réussi notre coup.
Vous avez connu le coté sans l’institution, et le coté avec…
Ah ben c’est mieux avec. Notre idée c’est de se dire que voilà, on est dans un environnement français qui fait qu’une partie de nos impôts partent vers des dispositifs culturels, donc il n’y a pas de raison que ces esthétiques en sortent. Après, on est vigilant pour ne pas s’institutionnaliser et devenir l’institution à la place de l’institution. Mais ça fait partie de l’évolution de ces cultures-là. C’est comme à l’époque, quand il y avait des artistes qui signaient sur des labels, une fois qu’ils étaient dans les maisons de disques, ils faisaient partie de l’industrie. Après c’est comment on gère tout ça, comment est-ce qu’on arrive à garder le lien avec le terrain. C’est pour ça qu’on n’a pas monté de structure associative pour le réseau hip hop, pour éviter de rajouter encore un étage en plus, rajouter des coûts. Ce qu’il y a, c’est que le volet pratique amateur n’était pas forcément pris en compte par la DRAC ni par la région, puisque ce n’est pas leurs compétences. Eux, ils sont sur la formation des artistes professionnels. Donc après c’est comment arriver à faire entendre à l’institution que parfois, il faut arriver à faire des entorses à leur schéma et dire que tant qu’il n’y a pas une pratique amateur forte, il y aura pas de professionnels derrière. Là, on est plus sur du socio-culturel que sur du culturel au sens dur. Et nous la question aussi, c’est de savoir comment on garde une forme, pas originelle puisqu’elle ne peut plus l’être, mais comment dans le cadre de l’organisation, on garde quand même une ouverture vers la spontanéité et une démarche qui reste fidèle à la culture hip hop.
« Les politiques et les services n’ont pas vraiment l’expertise nécessaire »
Après, ces cultures-là ont-elle vocation à s’institutionnaliser ?
Moi je ne pense pas que ce soit un problème. Après, quelle est l’expertise, à la fois des politiques et des services, là-dessus ? Si on pouvait comparer, ce serait comme si on disait : « Bah à l’opéra, on va mettre en tant que directeur de l’opéra André Rieu. » Enfin, l’objectif c’est d’arriver à ça. Sauf que les politiques et les services n’ont pas vraiment l’expertise nécessaire et que les acteurs ne sont pas à même de rendre visible certaines choses, et notamment de se regrouper, d’arriver à créer des initiatives collectives. Sur ces cultures populaires, il y a des choses à faire.
« On nous a fait manger du slam pendant 10 ans parce que c’était politiquement correct »
Vous par exemple, vous travaillez avec d’autres acteurs locaux ?
On a essayé pas mal de temps. Après la problématique, c’est que quand t’as pas de retour, ben y’a finalement rien qui t’encourage à ça. Le problème, c’est que l’institution te met aussi dans un schéma qui est celui de chacun va chercher ses subventions. Nous, on est a cheval sur de la culture, du sport, du socio-culturel. Donc on va aller voir des services, mais chacun est cloisonné dans sa démarche, donc il y a un manque aussi de la part de l’institution d’appréhension de toutes ces problématiques-là, qui posent des problèmes de représentation de certaines esthétiques. Il y a d’un coté la danse, d’un coté le théâtre, d’un coté l’audiovisuel… Et derrière, c’est vrai qu’on a essayé de faire des rapprochements avec le festival Tropisme (en ce moment à La Panacée), mais bon, tout le monde a la tête dans le guidon dans ses activités. Je le vois quand je discute avec des acteurs, ben chacun est dans son petit monde quoi, sectorisé par la consommation culturelle, les sites internet, les médias, l’institution. Sortir de ça, c’est compliqué. Pourtant, il y en a, des rapports, entre la culture hip hop et le rock par exemple, ne serait-ce qu’Afrika Bambaataa. Après c’est pareil sur le rap, on nous a fait manger du slam pendant 10 ans parce que c’était politiquement acceptable et maintenant on en entend plus parler. Maintenant on va nous dire c’est le street art et c’est pas le graffiti et il y a des street artistes qui vont sortir de l’espace temps, qui sont plus des graphistes que des artistes de rue.
« La ville de Montpellier est une ville universitaire avec un développement culturel qui a été basé sur la culture avec un grand C, élitiste »
C’est parce que c’est dans l’ère du temps ?
Non, c’est parce que ça correspond plus à l’institution. Le directeur de service ou l’élu il doit pouvoir aussi dire : « Je fais du slam, je fais pas du rap, parce que c’est de la poésie et pas de la culture populaire issue des ghettos. » On donne la légion d’honneur à Abd Al Malik et puis tout va bien quoi. L’artiste graffiti, il est plus vandale, ça devient un street artiste, c’est politiquement correct mais du coup, on détourne complètement à la fois le medium, la vocation, on détruit toute l’action culturelle qu’il va y avoir derrière, parce qu’on ne parle de rien. On en revient à la question de l’expertise, mais c’est aussi à nous d’adapter notre discours pour rendre compte de notre expertise. Et j’ai l’impression que nous sommes en ce moment dans une pauvreté, à la fois intellectuelle et budgétaire, qui fait que la marge de manœuvre est délicate. Tout ça cumulé à la réalité de la ville de Montpellier, qui est une ville universitaire, avec un développement culturel qui a été basé sur la culture avec un grand C, élitiste. C’est un quelque chose qu’il faut arriver à apprécier pour comprendre pourquoi on en est là. Puis c’est aussi des cultures jeunes, nous on est première génération d’acteurs, qui sommes maintenant à la tête de certaines structures avec ces rapports de capacité de dialogue avec l’institution. Il y a aussi des interlocuteurs qui comprennent et qui s’intéressent, qui sont dans un mode de fonctionnement normal, c’est-à-dire qu’ils s’adressent à des opérateurs culturels qui, eux, ont l’expertise pour pouvoir mettre en place des choses et qui ne veulent pas forcément « la place de », parce que ça aussi c’est souvent un problème. L’institution se substitue à l’opérateur culturel en donnant des directions, ou en produisant. Même maintenant comme on voit sur Montpellier avec les ZAT, ça devient la ville ou la direction de la culture qui produit de l’événement culturel à la place des opérateurs. Même si l’artiste est confié après à des équipes culturelles. Et puis, on sent aussi dans les nouvelles générations qu’il y a d’autres fonctionnements quoi.
Une volonté de se professionnaliser dans les nouvelles générations ?
Oui, avec d’autres outils aussi, avec internet où ils ont un accès à la diffusion qui est différent. Les choses se font à un autre niveau, nous on était vachement aussi dans une question de visibilité par l’événement ou par l’action, parce qu’il n’y avait pas tout ces réseaux sociaux, le seul moyen d’être visible, c’était dans des manifestations.
Et la suite là pour Attitude, vous avez des projets d’agrandissements ?
On est sur des choses à hauteur variable, des questionnements sur les différentes formes qu’on pourrait donner sur le festival Battle of the Year, on réfléchit à de nouveaux formats et après on continue à prendre des risques, pour justement être dans l’innovation et pas être dans une routinisation. Et ce qui est intéressant aussi, c’est de favoriser les échanges, les rapports humains, l’expérience. On a beaucoup développé sur les DOM TOM via le battle of the year, ce qui permet de mettre en place des actions complémentaires. Donc on va voir, avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale on va voir aussi ce que ça donne, on va laisser encore une petite année pour voir ce que ça dit. La fusion des régions, qui sur le réseau va aussi influencer, donc on commence à voir aussi avec nos collègues de midi Pyrénées qui sont un peu sur les mêmes esthétiques que nous, afin d’avoir une capacité de force de proposition pour la fin de l’année, ou au moins pour la rentrée prochaine.
Les financeurs que vous avez, c’est uniquement la région ?
On a la ville, la région, l’agglo, la DRAC, le ministère de l’Outre Mer, certaines années, des fondations. On va un peu chercher à droite à gauche…
Vous êtes combien de salariés ?
Nous on est trois à plein temps, il y a eu une période ou on était sept. La difficulté c’est ça, arriver à anticiper, suivre certaines évolutions. On a été sept en 2012-2013, et maintenant donc trois, avec des intervenants au niveau sportif ou culturel. En fait on est dans des phases de redressement, sur des cycles de confort relatif, d’inconforts. Mais bon on n’est pas à plaindre, c’est des choix qu’on fait. Même si c’est plus compliqué à 45 ans qu’à 25, il faut garder la fraicheur.